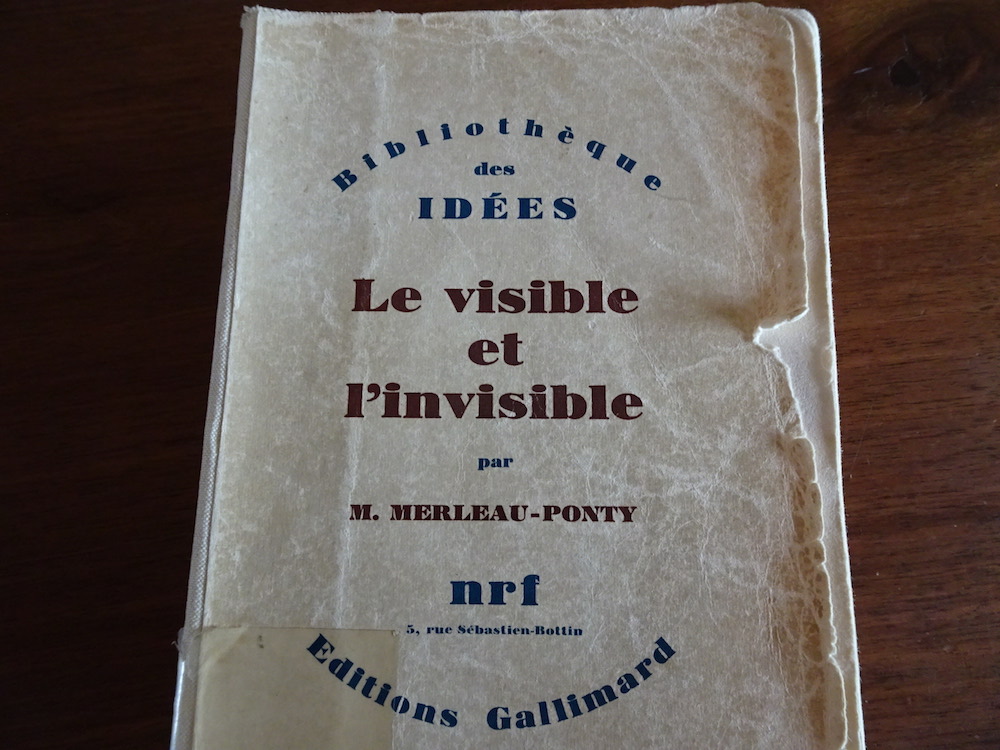Le temps qui passe apporte son lot de questions, sans questions il serait terne.
En 2023, j’ai accepté l’idée d’abandonner l’état « actif » ce qui signifie que sur les listes proposées à la fin des interrogatoires statistiques, je dois cocher l’ultime case, celle dans laquelle il est « normal » de mettre toutes les personnes qui vivent au crochet des « actifs », ceux qui cochent les cases d’au dessus. Dans ces bas-fonds, plus question de titres ni de diplômes, plus question de qualification, c’est l’antichambre vers l’oubli.
Les « boomers », ces « vieux schnocks » d’aujourd’hui disparaissent petit à petit, les plus célèbres offrant un espace aux spécialistes en nécrologie d’autant plus qu’ils se sont désespérément accroché à leur célébrité. Car certains sont incapables de laisser leur place aux jeunes, que ce soit en politique, dans le showbizz, partout où l’existence est intimement liée à l’exposition médiatique.
Enfant, je regardais les films western sur l’unique chaine de la télévision qu’il me fallait aller regarder chez ma grand-mère les jours sans école. Aucun salon ni aucun canapé à l’époque, c’est assise sur une chaise en paille devant la table de « salle à manger » que nous regardions la boite magique en sirotant du « pschitt » et en mangeant une tartine « beurre-chocolat ».
J’étais toujours « pour » les indiens.
J’étais fascinée par ces « sauvages ».
Un jour, je fus marquée par l’histoire d’une vieille femme qui s’éloignait de la tribu. Devenue inutile, elle partait finir ses jours au loin, seule afin d’éviter de devenir un poids pour les siens.
Je fus marquée.
Marquée au point de me dire que j’en ferai autant, un jour, lorsque le moment viendra.
Las, le temps des « indiens » est terminé.
Ni l’environnement sociétal ni l’environnement tout court ne se prête plus à ce genre de « disparition ».
Aujourd’hui, de mon point de vue, la personne vieillissante, vit une espèce d’adolescence à l’envers, un temps entre l’âge adulte (époque de productivité et de cotisations sociales) et l’ultime vieillesse croupissante qui parfois s’étiole infiniment dans les établissements spécialisés parce qu’il est interdit d’achever les humains, quand bien même ils ne sont devenus que charges et soucis incapables de communiquer.
Donc, me voilà vaillamment et joyeusement entrée dans cette drôle d’adolescence !
2024 marque mon retour en adolescence.
Une preuve s’il en était besoin : je monte à nouveau à cheval quasiment chaque jour.
Car le mot « adolescence » est une affaire de bavardage, de signifiant donc comme l’écrit le psychanalyste B.Nominé :

Et, je remarque que la première partie de l’article telle qu’elle apparait sur l’image ci-dessus pourrait tout à fait être plausible en remplaçant « jeune » par « vieux » ainsi il serait possible d’écrire :
« Je propose donc de situer l’adolescence entre la réalité biologique de la « ménopause/andropause » qui est un évènement du corps qui s’étiole, et le bavardage. »
Et plus loin :
« Ce qui va donner un statut à la vieillesse, et c’est la qu’on va trouver l’adolescence, c’est le fait de séparer les vieux des adultes au moyen de la retraite. »
Ca me fait rire.
Ce genre d’humour me comble sans jamais me désoler.