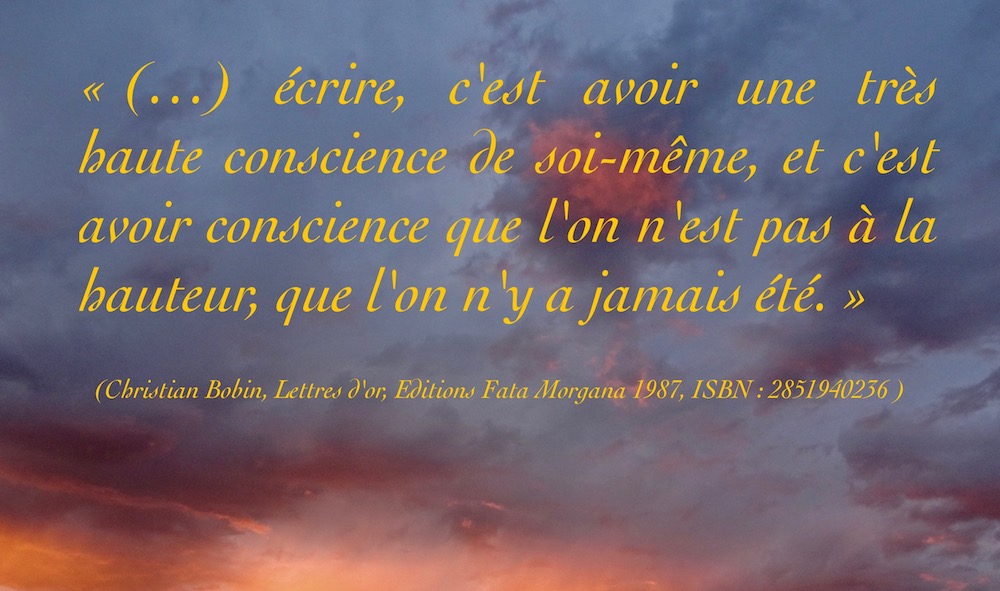Lundi 2 septembre 2013 : prologue Marseille-Marseille
Le dimanche soir, j’avais débarqué chez un hôte dont je ne connaissais pas grand chose de plus que l’adresse.
Dans les semaine précédentes, alors que j’avais envisagé plusieurs possibilités pour loger à proximité du point de départ, un inconnu m’avait envoyé un message pour proposer un accueil, j’avais dû répondre ce que je réponds souvent aux propositions : « c’est noté ».
C’est ainsi que se construisent mes aventures, en souplesse, sans contrainte : je note toutes les informations et in fine, je vais « où le vent me conduit ».
D’autres parleraient de hasard, mais il n’en est rien. La liberté première est celle de choisir, elle comprend même la liberté de choisir un mauvais plan. Le second volet de la liberté consiste à envisager les possibilités réellement existantes et à choisir une nouvelle fois. (pour ceux qui aiment la lecture, je conseille les réflexions sur la liberté proposées par le philosophe Robert Misrahi dans ce titre « La jouissance de l’être, Le sujet et son désir », Editions Encre Marine ou dans une autre partie de son oeuvre).
Donc, j’ai débarqué chez un hôte riche de plus d’une aventure au long cours. D’emblée, je me sentais parfaitement à l’aise, j’avais l’assurance d’être « comprise » et l’histoire pouvait commencer à la mesure de ce qu’elle devait être.
Le soleil était au rendez-vous, aucun vent mauvais n’était annoncé, il était l’heure de goûter l’ambiance de la Méditerranée en visitant Marseille côté mer. D’autres années, à plus d’une occasion (congrès et autre visites), j’avais erré dans la ville et ses fascinants quartiers. Ce que j’ai découvert ce lundi matin était pourtant absolument nouveau, rentrer dans Marseille par la mer offre un point de vue absolument différent et magique.
Il restait les sacs à préparer. Il restait à prendre une décision quant à la pagaie qui ferait les kilomètres en ma compagnie.
Mais auparavant, il fallait que je monte sur la colline comme le faisaient certainement ceux qui prenaient la mer à l’époque où il n’y avait ni GPS, ni météo marine officielle, il fallait bien s’en remettre au ciel, n’est-ce pas?
Donc, j’ai suivi leurs pas et je peux vous assurer que la lecture de quelques uns des milliers de « ex-voto » placardés sur les murs de « La bonne mère » mérite le détours.
Puis vint l’heure du repas, puis vint l’heure d’aller dormir.
Mardi serait le jour du départ : une calanque à Marseille, au lever du soleil, nous ne savions pas encore laquelle
Demain était à vivre.
Mardi 3 septembre 2013 : Marseilles (calanque Morgiou) – La Seyne-sur-mer (plage du Jonquet)
J’étais prête, archi prête.
Après une bonne nuit, je m’étais réveillée à l’aube sans la moindre sonnerie sinon « c’est aujourd’hui, c’est parti. »
Après un rapide p’tit-déj mon hôte sonna le moment solennel de charger la voiture.
Mais où allais-je prendre la mer?
A cette question, mon hôte malicieux ne savait que répondre dans l’instant. Pour l’heure, il n’était pas encore décidé : « on verra où tourne la voiture »!
Yeap… Ca m’allait carrément bien comme réponse!
Et… la voiture se dirigea vers les Baumettes ! Le point de mise à l’eau serait donc la Calanque Morgiou, la plus belle, un écrin spécial « point de départ », la porte de l’aventure.
Sur le parking, l’inévitable « pt’ite dame qui promène son chien » vint nous « intimer » l’ordre de nous garer serré à côté de l’unique voiture déjà présente à cette heure matinale : « soyez tranquille, nous ne faisons que passer » lui ai-je rétorqué sans imaginer un instant que j’allai répéter maintes fois presque les mêmes mots en accostant à peu près n’importe où
Enfin le départ. Au Cormier, j’avais testé l’accrochage des sacs et de la pagaie de secours, mais je sais parfaitement, que seul le voyage en détermine l’emplacement juste, et que les premiers jours servent toujours d’expérience « in situ ».
Allez, hop… le soleil montait tranquillement, il était temps d’y aller. Quelques photos et c’étaient les premiers coups de pagaies sur la « belle bleue ». D’abord prudente entre les barques, retenue pour laisser le photographe photographier, je n’avais qu’une hâte : partir!
Un signe de la main, quelques coup de pagaie plus appuyés… je regardais le « compagnon de départ – photographe » courir sur le chemin comme un gamin, et profitant encore de l’abri de la calanque, je me réjouissais de ce moment partagé.
Puis, en entrant dans le soleil, je tournais vers l’est, vers l’inconnu.
Voilà, j’étais vraiment partie!
Le massif des calanques m’impressionna beaucoup moins vu d’en bas que parcouru à la marche. Je n’avais pas la tête à m’y attarder et puis, j’avais le soleil de face : plus j’avançais plus il s’élevait, devenant plus ardent mais moins éblouissant.
Une fois Cassis dépassé, la couleur des roches tourna au rouge.
En arrivant en vue de La Ciotat, la faim m’a ramenée à la côte pour un arrêt sandwich bienvenu. Il était 11h, je n’était pas du tout fatiguée.
J’avalais la moitié du pain, en me promettant de « déguster » le reste un peu plus loin.
A 13h, dans la crique de Port D’Alon (Saint-Cyr-sur-mer) chauffée à blanc, j’ai trouvé un perchoir à l’ombre, c’était l’heure de la sieste!
Vers 15h, malgré la chaleur, j’étais de nouveau intenable, j’avais envie d’avancer.
Sur ce terrain, je ne pouvais m’empêcher de penser « à ceux d’ici » vantant leurs trajets au vent portant : sur la même trajectoire ce jour là le vent était absent, j’étais chargée… et lente!
Ayant tourné le cap Sicié j’ai aperçu pirogues, SUP et kayaks.
Visiblement il y avait un « club de pagaie » dans le coin.
Mon « soucis » du moment était entièrement contenu dans ce qui restait de ma réserve d’eau et je cherchais non seulement un endroit pour dormir, mais surtout un endroit où faire le plein du précieux liquide.
C’est un kayakiste qui m’a donné l’information : « il y a une source sur une plage là-bas! ». Il fallait que je retourne un peu en arrière, mais ça valait le coup, l’idée d’une plage loin de la ville et « juste pour moi » était absolument plaisante et réjouissante.